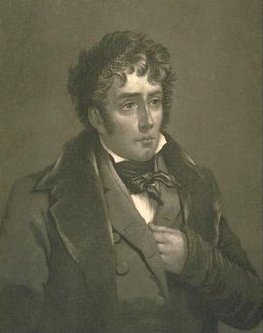Depuis deux semaines, les coquelicots commencent à fleurir nos collets. Mais que veut dire cette fleur? D'où vient-elle? Et surtout: on sait tous que c'est le jour du souvenir, mais... de quoi nous souvenons nous?
Tout d'abord, réglons la question du coquelicot, cette jolie fleur rouge. Le coquelicot est en fait ce que nous connaissons sous le nom de pavot. Ne partez pas en peur! Le pavot est légal (du moins, au Canada), et vous connaissez probablement quelques personnes qui en ont dans leur jardin. Ce qui est illégal, ce sont les graines de pavot, quand on les apprête pour en faire différentes drogues (à l'époque de la Grande Guerre, l'héroïne n'avait pas été inventée, mais on connaissait très bien l'opium, comme le démontre les fumeries qui fleurissaient un peu partout). La raison de son nom est fort simple: c'est une déviation du terme de l'ancien français cocorico (chant du coq), en référence à sa couleur similaire à celle du chef du poulailler.
Pourquoi portons-nous un coquelicot à notre collet le 11 novembre? Tout d'abord, simplifions les choses: le tout est un symbole du Commonwealth. Les Français, eux, utilisent les bleuets. Ensuite, deux origines sont présentée:
1. Le lieutenant-colonel canadien John McCrae, qui était du Corps de santé royal canadien, a écrit un poème en 1915, après avoir été témoin de la seconde bataille d'Ypres. Il y utilise le coquelicot comme allégorie. En voici un extrait (1):
In Flanders fields the poppies blow
(Dans les champs de Flandres, le coquelicot se balance)
Between the crosses, row on row
(Entre les croix, de rangées sur rangées)
That mark our place; and in the sky
(Qui marquent notre place; et dans les cieux)
The larks, still bravely singing, fly
(Les alouettes, chantant toujours avec courage, volent)
Scarce heard amid the guns below.
(Rarement entendues parmi les fusils qu'elles survollent.)
2. L'autre théorie est moins poétique. Les coquelicots poussaient sur les pires champs de bataille de la Somme et des Flandres. Les soldats auraient donc associé sa couleur rouge à celle du sang versé durant la guerre.
Mais maintenant, il faut se concentrer sur la vraie source du coquelicot: la Grande Guerre.
Cet article ne se veut pas un résumé de toutes les grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Il n'est pas exaustif non plus: certains sujets ont délibérément été mis de côté. Les commentaires qu'il contient n'ont pas été écrits pour choquer, et nous vous prions d'accepter nos plus plates excuses s'ils vous offensent. Si vous souhaitez partager des évènements s'étant déroulés durant la guerre, ou commenter sur ceux mentionner dans l'article, ne vous gênez pas pour poster des commentaires.
La Première Guerre mondiale prend sa source aussi loin que durant la Commune de Paris. Car la France, en 1870, se bat sur deux fronts: Paris, et les petits états de l'ancien Empire romain germanique.
En 1870, l'Allemagne comme nous la connaissons actuellement, n'existent pas: il s'agit, en fait, de plus de deux cent petites principautés allemandes, toutes indépendantes les unes des autres. La plus grande de ses principautés est la Prusse, mais celle-ci est divisée en deux par plusieurs États. Une première tentative d'homogénisation est tentée en créant la Zollverein, une union douanière afin que des marchandises puissent passer d'une section de la Prusse à une autre sans avoir à payer une taxe sur TOUS les petits états traversés. Mais la véritable union se produit avec Otto von Bismarck. (2) Bismarck a pour but de former une Allemagne unie. Il met donc en branle le stratagème suivant:
- Il place toute son armée à la frontière avec l'Autriche de l'empereur François Joseph Ier (oui, c'est celui de Princesse Sissi). Puis, il écrit une lettre à l'empereur Napoléon III en France: il lui dit qu'il s'apprête à envahir l'Autriche, et que, si Napoléon III se sentait l'envie de conquérir quelques petits états allemands à la frontière de la France, Bismarck ne s'opposerait pas. Napoléon III, heureux de tout cela, réécrit à Bismarck pour lui dire combien l'idée l'enchante et que, c'est bien d'accord, il va conquérir les petits états.
- Cependant, l'armée prussienne est déjà au porte de l'Autriche. À l'époque, lever une armée prenait plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. François-Joseph n'a pas le temps de lever une armée, et l'Autriche est vaincue en quelques semaines. Toutefois, l'empire austro-hongrois reste une puissance non-négligeable, et Bismarck ne veut pas s'en faire un ennemi, aussi signe-t-il un
traité assurant à l'Autriche la protection de l'Allemagne si celle-ci est attaquée.
- Entre temps, ses troupes étant occupés avec la Commune, Napoléon III n'a pas eu le temps de lever une autre armée pour aller conquérir les petits états dont il était question plus tôt. Bismarck, lui, trouve tout le temps d'envoyer la lettre que Napoléon lui a renvoyer aux journaux. Les états allemands sont indignés: quoi? Ce faire conquérir? Hors de question! Bismarck arrive avec la proposition suivante: la Prusse est toute puissante, elle vient de vaincre l'empire autrichien. Pourquoi ne pas s'allier à elle et vaincre les Français. On trouve l'idée plutôt bonne, on s'allie, et le plan de Bismarck fonctionne. On signe le traité mettant fin aux guerre Franco-Prussienne de 1870 à Versailles. Les états allemands et la Prusse sortent grands gagnants. Bismarck propose alors de s'allier sur le plan constitutionnel: l'Allemagne naît en 1871 (ce que l'on connaît comme le Deuxième Reich est compris de cette date jusqu'en 1918).
- Et qu'est-ce que l'Allemagne gagne, lors de ce traité? Tout d'abord, l'Alsace-Lorraine (3). Mais pourquoi est-ce que tout le monde est intéressé par ce territoire? Tout d'abord, sa forte population. Et ensuite, ses richesses naturelles. De plus, l'Allemagne impose une somme absolument gigantesque aux Français pour les dommages causés durant la guerre, plus à titre d'humiliation qu'autres choses.
Les guerres franco-prusses de 1870-1871 sont donc le dernier grand conflit avant la Première guerre mondiale. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on est en période de paix qu'on ne pense pas à la guerre. On crée de nouvelles armes. Mais on a pas d'occasion de les essayer. Et franchement, ça démange un peu de les tester.
Il y a aussi le problème des traités. Comme on l'a vu plus tôt, l'Allemagne défendera l'Autriche si elle est attaquée. Il y a aussi la France et l'Angleterre qui défenderont la Belgique. Et ça, c'est sans compter les colonies: l'Angleterre et la France se partage l'Afrique, avec ici et là des touches allemandes, portugaises, etc. L'Europe est en Asie (Vietnam, Inde, Hong Kong, etc.). Et enfin, il y a les colonies américaines: n'oublions pas que le Canada fait toujours partie du Commonwealth britannique, et que sa constitution ne lui a donné qu'une minime indépendance. Les États-Unis sont les seuls sur le continent américain qui entreront en guerre de leur propre gré.
Finalement, il y a les ambitions territoriales. L'empire d'Autriche-Hongrie, qui a déjà obtenu la Bosnie-Herzégovine, souhaite obtenir un accès à la Mer Noire. La Russie, qui ambitionne non seulement sur les Balkans, aimerait avoir un port donnant sur la Méditérannée en ayant les Détroits de Dardanelles et du Bosphore. Et, bien sûr, la France aimerait bien reprendre l'Alsace-Lorraine.
C'est bien beau tout ça, mais comment ça a commencé, la Première guerre mondiale? La réponse qu'on nous a forcé a apprendre par coeur est simple: c'est à cause de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand. Mais c'est qui, lui?
François-Ferdinand d'Autriche est l'héritier à la couronne autrichienne. Mettons tout de suite les choses au clair: ce n'est pas le fils de la princesse Sissi. En fait, c'est le fils du frère cadet de l'empereur François-Joseph Ier, mais après la mort du fils de celui-ci, il devient l'héritier de la couronne, étant le mâle le plus proche de la couronne d'un point de vue héréditaire. Lui et son épouse meurent le 28 juin 1914 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), victime d'un attentat par le serbe Gavrillo Princip, un étudiant. Mais en quoi c'est important?
La Bosnie-Herzégovine est passée, en 1878, de l'empire ottoman à l'empire autrichien, au mécontentement de la Russie, qui se consìdère comme la protectrice des Slaves. François-Joseph Ier (qui a maintenant 84 ans) voit ainsi le seul héritier possible pour la courrone autrichienne mourir, ce qui concrétise la fin de la maison de Habsbourg-Lorraine. L'affront est assez important pour déclarer la guerre.
L'Autriche déclare donc la guerre à la Serbie, en s'appuyant sur l'Allemagne. La Serbie, elle s'appuie sur la Russie. De manière préventive, l'Allemagne envahie la Belgique et le Luxembourg. La Belgique étant reliée par traités à la France et au Royaume-Uni, ceux-ci entre en guerre également. Et ainsi de suite.
La Première Guerre mondiale n'est pas une guerre mobile, comme la Deuxième. On organise des tranchées en face de celles de l'ennemis, on se tire dessus. On gagne quelques mètres. Le lendemain, on recommence. Cette fois-ci, on perd quelques mètres. Pas étonnant qu'à ce rythme-là, la Bataille de la Somme s'étende du 1er juillet au 18 novembre 1916.
Mais les tranchées présentent certains problèmes: les hommes sont proches les uns des autres. Les conditions sanitaires ne sont pas excellente. On meurt de la tuberculose, du typhus. L'hiver, il fait froid. L'été, il fait chaud. Les femmes sont loins. Les attaques sanglantes.
On se rend compte aussi de nouvelles difficultés, que les guerres en rang du XVIIIe et XIXe siècle ne nous ont pas montrés. Tout d'abord, les tranchés sont creusées à même le sol, et impliquent donc que certaines parties soient souterraines. Hors, après avoir tiré sur les tranchées ennemies, les soldats doivent se rendre dans les tranchées mêmes et achever les soldats à la baïonnettes. Comment savoir si certains ne se sont pas réfugiés dans un des tunnels? Effectivement, c'est le genre de chose qu'il est préférable avant de s'y retrouver, un couteau sur la gorge. On invente donc le lance-flamme. Et puis, ça en fait tout de même beaucoup à achever, des soldats, après les tirs, et la proximité des attaques à la baïonette traumatise. Comment réussir à diminuer au maximum l'ennemi avant d'envoyer les hommes dans les tranchées? Solution: le gaz moutarde (avis aux chimistes: sa formule est le C4H8Cl2S). En gros, lorsque l'on entre en contact avec ce gaz, on souffre de brûlure, mais alors là, extrême: celles-ci causent de la cécité, des brûlures aux poumons, sur la peau.
Lorsque la guerre est déclarée en août 1914, on pense qu'on pourra revenir avec la victoire pour Noël. La réalité est tout autre. L'Armistice est signée le
11 novembre 1918, à 11h00 (le 11/11 à 11: on pense ainsi que ce sera plus facile à retenir pour la population). On la termine par le traité de Versailles, en 1919,
dont je ne parlerai pas ici. La France et le Royaume-Uni sont grand vainqueur, au dépend de l'Allemagne et de l'Autriche. La Russie, aux prises avec la guerre civile, a signé une paix séparée en 1917. L'Italie, qui avait hésité entre les Alliés et la Triple Alliance, se trouve insatisfaite. Les bases de la Deuxième guerre mondiale sont jetées.
Mais avec tout ça,
pourquoi porte-t-on un coquelicot le 11 novembre?
On veut se souvenir des morts, des blessés, des vétérans. La Grande Guerre aurait fait 9 millions de morts, 8 millions d'invalides (selon le grand dieu Wiki, ça ferait 6 000 morts par jour). C'est un des conflits les plus meurtriers de l'Histoire. En France, par exemple, c'est toute une génération d'homme qui disparait, ce qui cause un vieillissement précoce de la population. Donc, on porte le coquelicot pour dire: plus jamais de conflits, parce qu'on ne veut plus jamais autant de morts.
La Première guerre mondiale n'était pas connu sous ce nom en 1914-1918: c'était la Grande Guerre. Après Versailles, c'est devenu la Der des ders, la guerre qui devait mettre fin à toutes les autres. Si ça continue comme ça, on a pas fini de le porter, notre coquelicot...
Toujours là? Le sujet vous intéresse? Vous voulez poussez plus loin vos connaissances sur le sujet?
Des documentaires. Des playlists sur YouTube et Dailymotion ont été ajoutées sur mon compte par rapport à ce sujet.
Des films. Depuis le début du XXIe siècle, les films sur la Première Guerre mondiale ont le vent dans les voiles. À noter les films français Joyeux Noël (basé sur des évènements historiques, représente très bien la difficulté de la vie quotidienne dans les tranchées tout en donnant un regard humain sur la guerre) et Un long dimanche de fiançailles (sur les conséquences suivant la guerre sur les civils et les soldats, avec une vue plutôt réaliste sur la vie dans les tranchées et la justice militaire de l'époque). Et, bien sûr, le traditionnel À l'Ouest, rien de nouveau (All Quiet on the Western Front), pour les fans du cinéma américain du début des années 1930.
Des romans. Parce que, avant d'être un film, l'écrivain allemand Erich Maria Remarque a écrit le roman À l'Ouest, rien de nouveau en 1929.
Des poèmes. Parce que la Grande Guerre a donné naissance aux mouvements surréalistes et dadas, la poésie abonde sur la guerre de 14-18. Guillaume Appolinaire, précurseur du surréalisme, est d'ailleurs mort en 18 à la suite d'une blessure de guerre. Du côté anglais, Wilfred Owen retient l'attention, avec des poèmes comme (
Dulce Et Decorum Est, Anthem for Doomed Youth). Owen a écrit ces deux poèmes alors qu'il était lui-même dans les tranchées.
Dulce Et Decorum Est contient d'ailleurs une excellente description des effets du gaz moutarde (le poème a été illustré par des dessins animés 3D plutôt réalistes sur YouTube par le vidéo suivant:
http://www.youtube.com/watch?v=P4Lzo_EXXOQ)
En parallèle. Deux évènements ont retenu l'attention entre 1914 et 1918 (autre que la guerre, bien sûr). Le premier, aux répercussions immédiates, fut la Révolution russe de 1917, qui eut pour conséquence la chute du tsarisme et l'assassinat de la famille royale. Si vous vous intéressez à la Révolution russe, les deux documentaires suivants peuvent vous intéressé.
Si vous êtes plus intéressée par le sort de la famille de Nicolai II, vous pouvez aller voir les deux documentaires suivants:
L'autre cas s'étant déroulé durant la première guerre mondiale est l'exécution de Mata Hari, accusé par les Français d'espionnage pour le compte de l'Allemagne. Secret d'Histoire, le 24 février 2008, lui a consacré un épisode (
http://www.youtube.com/watch?v=_1BnMeWReb0&feature=&p=2C61C6501489ABC1&index=0&playnext=1)
Si vous avez des anecdotes, des informations ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer!
**********
(1) McCrae, John. "In Flanders Fields."
Wahington State University.
http://www.wsu.edu:8080/~wldciv/world_civ_reader/world_civ_reader_2/mccrae.html (accédé le 8 novembre 2010)
(2) Le présent paragraphe est, en gros, un résumé extrême de mon cours d'Histoire de secondaire 5.
(3) Comme on m'a déjà dit que la Lorraine n'avait jamais été échangée, il faut que je mette une source ici: Krebs, Gilbert. "La question d'Alsace-Lorraine."
La naissance du Reich. sous la dir. de Gilbert Krebs et Gérard Schneilin.
http://books.google.ca/. Désolée à tous les Lorrains et Lorraines! Je ne veux pas froisser quique ce soit!